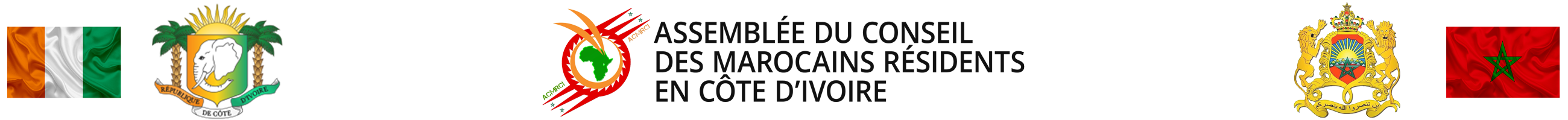Les politiques d’austérité imposées par le Fonds Monétaire International, conjuguées aux flux financiers illicites et au néocolonialisme économique, limitent la capacité des États africains à combattre efficacement les inégalités. Dans ce cadre, Oxfam préconise une réforme fiscale ambitieuse pour générer des ressources indispensables au financement des services publics et à la réduction de la pauvreté.
Le dernier rapport d’Oxfam publié en juillet 2025 met en lumière une réalité économique alarmante en Afrique. La concentration extrême et durable de la richesse profite à une minorité restreinte. Les quatre milliardaires les plus riches du continent détiennent une fortune supérieure à celle de la moitié la plus pauvre de la population africaine, soit près de 750 millions de personnes. Cette fracture sociale s’accentue, alors que la richesse des super-riches croît bien plus vite que la croissance économique générale.
Au cours des cinq dernières années, le patrimoine des 5 % des personnes les plus aisées en Afrique a augmenté de 88 %. Cette progression est largement déconnectée de l’évolution du produit intérieur brut (PIB) du continent, et de la dynamique de création d’emplois. La fracture sociale reste particulièrement prononcée, même dans les économies africaines les plus prospères. Le coefficient de Gini, qui mesure les inégalités de revenus, demeure élevé, voire en progression. Près de la moitié des pays africains ont vu leurs inégalités se stabiliser ou s’aggraver durant la dernière décennie.
À l’aube de la première présidence africaine du G20 portée par l’Afrique du Sud, et alors que l’Union africaine s’est engagée à réduire les inégalités de 15 % d’ici 2034, Oxfam rappelle que cette situation n’est pas une fatalité, mais le résultat de choix politiques délibérés. Kwesi Obeng, responsable de la reddition des comptes et de la gouvernance pour l’Afrique au sein de l’ONG, souligne que « les inégalités sont le fruit d’une volonté politique, et non d’une nécessité économique ».
Le creusement des inégalités coïncide avec un recul préoccupant des politiques publiques destinées à les atténuer. En 2023, tous les États africains ont réduit les ressources allouées aux secteurs essentiels que sont la santé, l’éducation et la protection sociale. Paradoxalement, le poids du service de la dette publique absorbe désormais une part plus importante des budgets que ces secteurs clés.
En dix ans, la dette publique africaine a doublé et atteint désormais 67 % du PIB continental. En moyenne, 54 % des recettes fiscales sont consacrées au remboursement de cette dette, au détriment des investissements dans les infrastructures et les programmes sociaux nécessaires à un développement inclusif.
L’une des causes profondes de ces disparités est la nature même des systèmes fiscaux en Afrique, largement basés sur des taxes indirectes telles que la TVA, qui représentaient 52 % des recettes fiscales en 2022. En revanche, l’impôt sur la fortune contribue à peine à hauteur de 2 %, accentuant une charge fiscale disproportionnée pesant sur les populations les plus vulnérables, déjà exposées à la hausse des prix et à l’inflation.
Cette structure fiscale régressive signifie que pour chaque dollar collecté via les impôts directs sur le revenu ou la richesse, trois dollars proviennent des taxes à la consommation. À titre d’illustration, le groupe industriel nigérian d’Aliko Dangote a versé seulement 2 % d’impôts sur ses bénéfices en 2016, un taux extrêmement faible comparé à ses capacités.
Par ailleurs, près de 80 % des pays africains ont réduit leurs politiques fiscales progressives ces dernières années, renforçant encore davantage la pression fiscale sur les classes moyennes et populaires.
Afrique : l’austérité et l’évasion fiscale, un frein lourd à la justice sociale
Le rapport dénonce également l’impact des politiques d’austérité dictées par le Fonds Monétaire International (FMI), qui limitent la marge de manœuvre budgétaire des États africains et leur capacité à investir dans les services publics indispensables à la réduction des inégalités. À cela s’ajoutent les flux financiers illicites qui privent le continent de ressources considérables.
Autre facteur : la persistance d’un néocolonialisme économique, où l’extraction massive des ressources naturelles du continent s’effectue sans retombées équitables pour les populations locales, perpétuant une dépendance économique et une répartition inégale des richesses.
À ce rythme, Oxfam estime qu’il faudrait plus de six siècles pour éradiquer l’extrême pauvreté en Afrique. Pourtant, l’ONG démontre que des politiques ambitieuses visant à réduire les inégalités de seulement 2 % par an pourraient sortir 71 millions de personnes de la pauvreté en cinq ans, soit un rythme 2,4 fois plus rapide que le scénario actuel.
Pour concrétiser cet objectif, Oxfam propose une réforme fiscale ambitieuse : augmenter de 10 points le taux d’imposition sur les revenus des 1 % les plus riches et d’un point sur leur patrimoine. Cette mesure permettrait de générer jusqu’à 66 milliards de dollars supplémentaires chaque année, des ressources cruciales pour financer des services publics renforcés.
Certains pays africains montrent déjà la voie : alors que la moyenne continentale des recettes foncières plafonne à 0,3 % du PIB, le Maroc et l’Afrique du Sud ont atteint respectivement 1,5 % et 1,2 %. Si d’autres États suivaient cet exemple, 34 milliards de dollars supplémentaires pourraient être mobilisés annuellement pour l’éducation, la santé et la protection sociale.
L’année 2025 s’annonce décisive, avec l’adoption d’un nouveau cadre onusien pour le financement du développement, la présidence africaine du G20 et le lancement de négociations historiques sur une convention fiscale internationale portée par les pays africains.
Cette conjoncture offre une opportunité exceptionnelle aux dirigeants du continent pour initier des réformes structurelles majeures, réduire les inégalités et engager un développement véritablement inclusif, au bénéfice de tous les Africains.
Maroc diplomatique