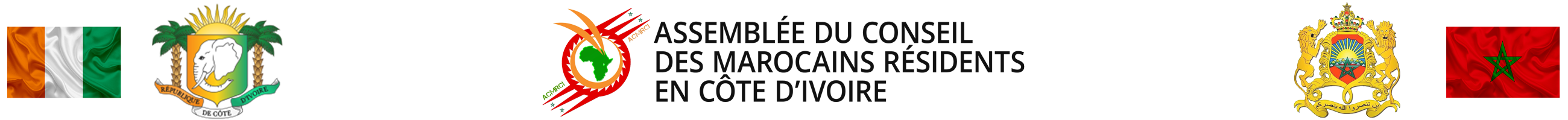L’essor du numérique dans le Royaume, accéléré par la généralisation des réseaux sociaux et la pandémie de la COVID-19, a ouvert de nouveaux horizons d’expression, de travail et de citoyenneté. Mais il a également donné naissance à des formes inédites de violences, plus insidieuses et plus difficiles à appréhender : les violences basées sur le genre, amplifiées par les outils numériques.
Harcèlement en ligne, campagnes de dénigrement, diffusion non consentie d’images intimes, manipulation de contenus à travers des deepfakes ou encore divulgation d’informations personnelles sont autant de pratiques qui exposent les femmes à des atteintes graves, souvent silencieuses. Ces violences numériques, loin de se limiter à l’espace virtuel, débordent fréquemment dans la vie réelle, traduisant la gravité d’un phénomène qui n’est pas anodin.
Selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP), 1,5 million de femmes ont déjà été victimes de violence numérique dès 2019, soit 14 % de la population féminine. En 2021, une enquête d’ONU Femmes révélait que plus de la moitié des Marocaines interrogées avaient subi une forme de violence sexiste en ligne, et qu’une sur trois avait vu ces attaques se prolonger hors ligne. Ces chiffres mettent en lumière une menace qui pèse à la fois sur l’intégrité psychologique des victimes et sur leur droit à participer à la vie publique.
Au-delà de l’impact direct sur la santé mentale, avec anxiété, dépression ou perte d’estime de soi, ces violences ont pour conséquence d’exclure de nombreuses femmes d’un espace numérique devenu indispensable pour apprendre, travailler et s’engager dans la société. Le retrait forcé des victimes témoigne de la capacité de ces attaques à marginaliser encore davantage des voix essentielles dans l’espace citoyen.
Le Royaume dispose, certes, d’un arsenal juridique composé du Code pénal, de la loi 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, de la loi 05-20 sur la cybersécurité, ainsi que d’engagements internationaux tels que la Convention de Budapest et la CEDEF. Mais dans les faits, ces textes demeurent insuffisants. En l’absence de définition claire de la violence numérique, certaines contradictions juridiques et des dispositions perçues comme liberticides compliquent l’accès à la justice et alimentent un climat d’impunité.
Cette fragilité est renforcée par un faible taux de signalement. Selon le HCP, entre 68 % et 77 % des victimes choisissent de ne pas porter plainte, faute d’information sur leurs droits ou par manque de confiance dans les mécanismes de recours. Ce silence contraint entretient la persistance du phénomène et retarde la mise en place de solutions efficaces.
Devant ce constat, les associations préconisent un ensemble de mesures essentielles : la nécessité d’introduire une définition précise des violences numériques dans le cadre législatif, d’adapter les sanctions aux nouvelles formes de cyberviolence, de renforcer les mécanismes de signalement et de protection des victimes, mais aussi d’intégrer l’éducation numérique dans les programmes scolaires afin de sensibiliser dès le plus jeune âge au respect, en ligne comme dans la vie réelle.
Le rôle des acteurs technologiques est également central. La mise en place d’outils de modération, de systèmes de protection renforcés et de canaux de recours simples et sécurisés apparaît indispensable pour contrer la diffusion de contenus violents et protéger les victimes.
Les violences numériques ne constituent pas seulement un problème individuel, elles traduisent une faille structurelle qui prolonge les inégalités et réduit au silence des voix féminines indispensables dans l’espace public. Protéger les victimes et briser le cycle de l’impunité, c’est garantir que l’espace numérique reste un lieu de liberté, d’égalité et de participation pour toutes et tous.
Maroc diplomatique