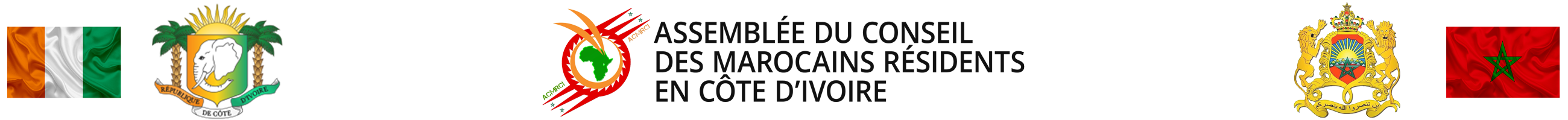La montée en puissance des insurrections islamistes au Sahel, en Somalie et dans le bassin du lac Tchad illustre l’ampleur de la menace sécuritaire qui pèse sur le continent. Selon le Centre africain d’études stratégiques, plus de 150 000 Africains ont perdu la vie au cours des dix dernières années dans des violences attribuées à ces groupes.
L’Afrique a franchi un seuil dramatique. Les violences liées aux groupes islamistes militants ont provoqué environ 155 000 décès en dix ans, selon le Centre africain d’études stratégiques (CAES). L’année écoulée a été particulièrement meurtrière, avec 22 307 morts, soit un niveau de létalité record et une augmentation de 60 % par rapport aux années 2020-2022.
La concentration géographique de la violence reste frappante : le Sahel (10 685 décès) et la Somalie (7 289 décès) représentent à eux seuls près de 80 % des victimes. Avec le bassin du lac Tchad, ces trois foyers comptabilisent 99 % des décès attribués aux islamistes militants en 2024-2025.
Le CAES souligne que ces chiffres ne traduisent qu’imparfaitement la réalité, les restrictions imposées aux médias dans certaines zones, notamment par les juntes sahéliennes, rendant difficile la collecte indépendante de données fiables.
Le Sahel est aujourd’hui la région la plus meurtrie. Entre 2020 et 2023, la moyenne annuelle des décès s’élevait à 4 900 ; elle a doublé au cours des trois dernières années, atteignant désormais 10 500. Depuis 2019, le nombre de morts y a été multiplié par sept.
Les groupes affiliés à Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimeen (JNIM), branche sahélienne d’Al-Qaïda, sont responsables de 83 % des décès. Avec 6 000 à 7 000 combattants, ils ont étendu leur emprise du Mali et du Burkina Faso vers les zones frontalières des pays côtiers. L’État islamique au Grand Sahara (EIGS), fort de 2 000 à 3 000 hommes, demeure un rival mais aussi un allié ponctuel du JNIM.
Le Burkina Faso est désormais l’épicentre de la crise, concentrant 55 % des décès sahéliens en 2024-2025. Selon le CAES, les forces burkinabè ne contrôlent plus que 40 % du territoire. Le Mali, quant à lui, a enregistré 17 700 morts depuis 2009, dont 81 % postérieurs au coup d’État militaire de 2020.
La Somalie, foyer djihadiste persistant
En Somalie, la menace reste dominée par Al-Shabaab, actif depuis 2006 et disposant de 7 000 à 12 000 combattants. Le groupe génère jusqu’à 200 millions de dollars de revenus annuels, équivalents à ceux du budget de certains États fédérés somaliens.
Le pays a connu une recrudescence de la violence depuis l’élection du président Hassan Sheikh Mohamud en 2022 et la contre-offensive d’Al-Shabaab. Selon le CAES, les 6 224 morts enregistrés en 2024-2025 représentent le double du bilan de 2022.
La coopération d’Al-Shabaab avec les Houthis du Yémen a renforcé ses capacités technologiques, en particulier l’usage de drones et de missiles balistiques, ce qui a amplifié l’impact de ses offensives dans le centre et le sud du pays.
Le bassin du lac Tchad : une menace résiliente
Le bassin du lac Tchad a comptabilisé près de 4 000 morts en 2024-2025, une hausse de 7 %. Les factions de Boko Haram et de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (EIAO) conservent une capacité opérationnelle inquiétante.
Le Nigeria concentre 74 % des décès régionaux, en particulier dans l’État de Borno. Boko Haram, estimé entre 1 500 et 2 000 combattants, et l’EIAO, entre 4 000 et 7 000, se livrent une concurrence meurtrière, notamment pour le contrôle des bases militaires et l’usage accru de drones armés.
Selon le Centre africain d’études stratégiques, la violence contre les civils y a atteint en 2024 son plus haut niveau depuis 2016, avec 880 morts, reflétant la fragmentation croissante de ces groupes.
En Afrique du Nord, la violence islamiste est en déclin constant depuis 2016. En 2024-2025, seuls 17 décès ont été recensés, tous en Algérie, liés à de petites cellules locales. Toutefois, le CAES relève que la Libye continue de servir de plateforme logistique aux groupes du Sahel, maintenant un risque structurel de déstabilisation régionale.
À l’heure où les violences s’étendent désormais aux pays côtiers d’Afrique de l’Ouest – avec une hausse de 129 % des décès au Bénin et un doublement au Togo – la menace tend à se rapprocher de zones jusqu’ici épargnées.
Maroc diplomatique